|
|
 |
Chamanes et guérisseurs : des mondes à découvrir

Selon l’ethnopsychiatrie, c’est au praticien de s’adapter à la culture de son patient, aussi éloignée soit-elle de la nôtre. Au prix de l’abandon de toute certitude en matière de santé mentale.
J’ai été en poste à Conakry, en Guinée, de 2009 à 2011, en tant que conseiller de coopération et d’action culturelle. Le 28 septembre 2009, le pouvoir en place a réprimé une manifestation d’opposants politiques avec la plus extrême violence. Expédiant ses « bérets rouges » dans le stade où s’était réunie la manifestation, il a fait tirer dans la foule. Les soudards se sont aussi livrés à toutes sortes de brutalités. On ne connaît pas le chiffre exact des morts, mais on l’estime à plus de 200. Plus de 150 femmes ont été violées. Les blessés – plus de 2000 –, les femmes violées, les survivants qui ont assisté aux exactions, avaient besoin de toute une variété de soins, y compris psychologiques.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’en Guinée la proportion de personnels de santé par habitant est de l’ordre de 1 médecin pour 10 000 habitants (Soudan : 3 ; France : 30 ; Italie : 34 ; Autriche : 48) et de 1 infirmier pour 6 343 habitants. Un seul hôpital national public (l’hôpital Donka) possède un service de psychiatrie (environ une centaine de lits). Il n’existe aucun lit de psychiatrie dans les hôpitaux généraux. Selon les années, on peut trouver entre 1 à 3 psychiatres pour tout le pays (tous à Conakry) – lors des événements que j’évoquais, il y en avait un seul. Il n’existe pas de psychologues en Guinée ; la discipline n’y est pas enseignée. À qui donc s’adressent les malades ? Nous le savons : ils se rendent chez les guérisseurs musulmans (karamokos) ; au village, chez les guérisseurs traditionnels (djinnatigis, nyamakalas, féticheurs) ; ou encore, pour les chrétiens, dans les églises évangéliques, d’obédience pentecôtiste.
Comprendre la façon dont les désordres – appelons-les « psychiques » pour l’instant – sont pensés et pris en charge dans ces lieux « traditionnels », est une exigence à la fois méthodologique et politique.
Techniques traditionnelles
Existe-t-il un lien entre la psychothérapie et les techniques thérapeutiques traditionnelles ? Une définition de la psychothérapie en tant que thérapeutique par l’esprit exclut de fait les thérapeutiques auxquelles recourent la majorité des malades à travers le monde. Car ces thérapeutiques prétendent agir sur des invisibles (divinités, esprits, démons) ou sur la conséquence d’actions invisibles (sorcellerie, maléfices, envoûtement) et non pas sur une hypothétique « psyché ». Elles procèdent à l’aide de rituels, de sacrifices animaux, de fabrication d’amulettes, de prières ou d’extraction d’objets-sorts… Elles laissent rarement place à la parole et, quand c’est le cas, il s’agit d’une parole ambiguë, parfois dans un langage ésotérique que ne comprend pas le patient. Tenter à tout prix de faire entrer ce genre de dispositif de soin dans le carcan des concepts de notre psychologie, aboutit à disqualifier les patients et les professionnels de ces mondes.
Soit du fait de nécessités économiques, comme dans l’exemple guinéen évoqué en préambule, soit à cause de l’attachement des populations envers leurs techniques « traditionnelles », les malades continuent à fréquenter ces lieux de soin. Pour exemple, selon des statistiques récentes, 90 % des malades consultent un guérisseur aujourd’hui encore au Sénégal. Après plus d’un siècle d’existence, la psychothérapie n’est pas parvenue à convaincre les usagers de l’universalité, décrétée a priori, de ses concepts.
Il serait même difficile de retenir une définition plus large, telle par exemple que « thérapie », sans préciser « psycho », qui engloberait dans la même catégorie les psychothérapies et les techniques des mondes éloignés, tant ces dernières semblent relever d’une autre logique. À vrai dire, elles se rapprocheraient davantage des médecines organiques, définissant des êtres invisibles à l’œil nu (ici des microbes ou des bactéries, là-bas des esprits), usant de méthodes de diagnostic incluant des appareillages complexes (divination par les cauries, par le sable, par les boîtes à souris, par le déplacement d’animaux tels que le « renard pâle » (1) ou la grenouille). Un guérisseur béninois me désignait son dispositif de divination à l’aide du chapelet de noix (le Fa), comme étant son scanner.
Pour le dire de manière schématique, les thérapies traditionnelles ont peu de choses en commun avec les psychothérapies. Les théories du mal, les êtres incriminés, les objets utilisés, les techniques d’intervention, les caractéristiques du thérapeute, son initiation, ses relations avec le groupe social…, autant d’éléments qui spécifient une forme de thérapie, sont radicalement distincts.
L’erreur des études de type « psychiatrie transculturelle » (encadré ci-desous) a été de partir de l’observation des malades, postulant que l’on appliquait à un mal identique (schizophrénie ou dépression, par exemple) des traitements différents selon les cultures. Cette proposition, provenant la plupart du temps de cliniciens recherchant dans les observations anthropologiques la confirmation de leurs théories, a nécessairement conduit au rejet des concepts des mondes éloignés.
L’ethnopsychiatrie a posé la question de manière toute différente. Elle a considéré que les entités, tant celles des psychothérapies que celles des thérapies traditionnelles, sont des sortes « d’êtres vivants », recrutant des sujets – on devrait parler ici de « captures », au sens de Gilles Deleuze. On doit donc considérer que les malades sont « fabriqués » par ces entités que sont, par exemple, ici « la dépression », là-bas « la possession ». Ces entités occupent des « niches écologiques » (2) comportant à la fois la définition du désordre, la forme qu’il peut prendre, mais aussi la nature du thérapeute susceptible de le prendre en charge et les moyens techniques dont il dispose. Pour exemple, la dépression a éclaté en Occident comme une véritable épidémie (3), au même moment que de nouvelles molécules appelées « antidépresseurs » ont été mises sur le marché. On a donc assisté à la création d’une telle niche écologique. Cette entité a eu un tel succès que l’on considère aujourd’hui que 15 à 20 % des personnes en présenteront les symptômes à un moment ou un autre de leur vie. De même, doit-on considérer la possession, non pas comme une « maladie » qui frapperait un individu, mais bien comme une niche écologique dans laquelle seraient regroupés les esprits susceptibles d’investir les personnes, leurs noms, leurs modalités d’entrée en relation avec les humains, le type de guérisseur susceptible de médiatiser cette relation, les façons de les apaiser…
Ainsi s’agit-il d’observer les systèmes thérapeutiques et non les patients – tous les systèmes, sans exclusive ni hiérarchie, qu’ils se revendiquent « savants » ou qu’ils se présentent comme spécifiques d’un collectif ou d’une communauté ethnique, religieuse ou sociale.
Les applications de l’ethnopsychiatrie
Rebelle par nature dès sa création, l’ethnopsychiatrie a conservé dans ses applications une dimension politique. Elle a pris conscience très tôt de la métamorphose de la société française, désormais multiculturelle. Elle s’est révélée d’une particulière efficacité dans la prise en charge des patients migrants provenant de mondes éloignés.
J’ai créé la première consultation d’ethnopsychiatrie, il y a de cela plus de trente ans, dans le service de psychiatrie de l’hôpital Avicenne, alors dirigé par Serge Lebovici à Bobigny. Au début, nous recevions encore des patients portugais et maghrébins. Par la suite, sont arrivés les patients originaires d’Afrique subsaharienne, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Congolais. Puis ceux provenant d’Asie du Sud-Est, les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Chinois. Nous avons accueilli dans ces consultations les migrants chassés de leurs pays au rythme des déflagrations de la planète.
Conformément à la méthodologie ethnopsychiatrique, telle que j’en ai schématiquement brossé les contours, nous avons tout fait pour les comprendre à partir des langues, des pensées et des techniques de leur monde. Nous avons dû à chaque fois nous adapter, inviter des interprètes, mobiliser des recherches dans les cultures d’origine des patients, tenter d’apprendre leur monde – ou plutôt d’en apprendre un peu plus sur leur monde (4).
Le clinicien qui pratique ce type de consultation, quelle que soit par ailleurs sa compétence, se trouve perpétuellement en apprentissage, plongé par méthode dans des univers qui le fracturent. Il lui faut par exemple manier avec gravité des notions qui le disqualifient en tant que savant aux yeux de ses pairs. Il est ainsi conduit à prendre au sérieux les êtres invisibles dont l’action a désorganisé l’univers de ses malades. Il devient inéluctablement partenaire d’esprits de la brousse, de génies ou d’ancêtres. Il lui faut parcourir avec ses patients l’écologie des djinns maghrébins (5), les modalités d’installation des vodúns béninois, les précautions indispensables à l’entretien des kriss malais, que sais-je encore… Le principe est toujours de connaître au plus près les procédures auxquelles se soumettraient les patients s’ils étaient restés au pays, ou quelquefois s’y soumettent en France. Il devra adopter une position intérieure qui évite à la fois le piège de la condescendance (je fais mine d’y croire puisqu’ils y croient) et le leurre de la naïveté. Pour prendre ce seul exemple, les rituels de possession ne sont pas seulement des thérapies ; ils relèvent aussi de la religion, de « la fête », de l’activité politique, de l’écologie… Ils font partie de la part la plus sensible des personnes, leur identité, fût-elle transitoire, leur adhésion à leur communauté.
Nous avons donc appris une forme de psychothérapie qui nous met en relation avec des humains attachés et non pas des « hommes nus » – attachements à des langues, à des idéologies, à des lieux, à des groupes, à des forces, à des « choses ». Et nous avons découvert que ces attachements méritent d’être étudiés, même s’il arrive souvent aux humains de se révolter contre les forces qui les lient, de se démarquer de leurs fidélités, de se séparer de leur famille ou de se détacher de leurs dieux…
Modernités
Cet apprentissage indispensable à la prise en charge des patients provenant de mondes éloignés nous a rendus familiers avec les groupes. L’ethnopsychiatrie se pratique en effet en groupe, incluant nécessairement des représentants des mondes du patient – sa famille, ses référents, les assistantes sociales qui ont accompagné ses démarches, les médecins qui l’ont suivi un temps, ses voisins peut-être. Les cliniciens se retrouvent aussi en groupe, incluant des interprètes, des anthropologues, des chercheurs, des philosophes. Il nous faut penser plus avant, ne pas craindre les innovations, oser des idées inattendues. Il n’est pas rare que de telles consultations rassemblent jusqu’à 15 personnes pour traiter du même problème.
Riches de cette expérience, nous avons appliqué la même méthodologie à certaines situations spécifiques que l’on rencontre dans les mondes modernes. Nous avons organisé des consultations, sur le même modèle, avec les sortants de sectes (6), avec les transsexuels en demande d’intervention chirurgicale (7), avec les boulimiques, les bipolaires… À chaque fois, nous les avons abordés à partir de leurs attachements, nous alliant aux associations dans lesquelles ils s’étaient regroupés. Nous avons ainsi transformé l’espace psychothérapique, manquant pour le moins de transparence, en un lieu de débat contradictoire.
L’ethnopsychiatrie, pratiquée avec les patients migrants, nous aura enseigné quelques principes qui balisent aujourd’hui notre philosophie de l’action :
- Penser les patients « attachés », ce qui conduit nécessairement à collaborer avec les collectifs auxquels ils adhèrent ou bien avec ces forces sociales montantes que sont aujourd’hui les associations de patients regroupés autour d’une même entité.
- Participer à la diffusion démocratique des connaissances – notamment via Internet afin de rendre les malades aussi savants que leurs thérapeutes.
- Renoncer au secret – dont on sait qu’il n’est que de polichinelle, puisque réservé au seul patient alors que les thérapeutes communiquent librement entre eux. Autrement dit, expliciter au patient la théorie que l’on nourrit au sujet de son mal.
- Favoriser le témoignage des patients sur leur propre mal, plutôt que les traditionnelles « études de cas ». Ainsi compareront-ils leurs symptômes pour constituer des corpus enfin fiables.
- Une telle thérapie, lorsqu’elle se révèle efficace, finit par transformer le patient en témoin, dont l’expérience du mal constitue une richesse à partager avec le monde.
- À condition de respecter ces principes, l’ethnopsychiatrie se révèle une psychothérapie particulièrement adaptée à un monde moderne, ouvert et démocratique.
La folie, initiation du thérapeute
Le personnage du thérapeute traditionnel est un être singulier. Sa longue fréquentation des invisibles provient, pense-t-on, d’une capacité particulière à établir un commerce avec eux. La façon dont on le désigne dans les langues ne laisse pas de doute sur sa nature. Les Yorubas du Bénin et du Nigeria l’appellent « baba lawo », « maître du secret », ce qui est aussi le sens du mot « karamoko » en malinké, ou « mori », en arabe. Il s’agit d’un initié au savoir secret. Sa formation tient bien plus de l’apprentissage auprès d’un artisan que d’un enseignement. Par ailleurs, dans bien des dispositifs thérapeutiques traditionnels, on s’attend à ce que le thérapeute prenne contact avec sa vocation au cours d’une crise initiatique qui ressemble à s’y méprendre aux maladies qu’il aura à soigner par la suite. Le « docteur » est donc ici un malade avant d’être un guérisseur. Le cas extrême est celui du chamane sibérien qui, lors de sa crise initiatique, traverse un véritable épisode de folie, qui se reproduira par la suite bien des fois.
L’on pourrait presque décrire ce thérapeute comme l’inverse du psychothérapeute ou du psychiatre. La plupart du temps vêtu de manière fantasque, couvert de breloques et de gris-gris, c’est lui et non le malade qui saute, s’agite, crie, prononce des paroles incompréhensibles ; lui qui est pris d’hallucinations, qui s’adresse à des êtres invisibles, les argumente et même se bat avec eux… C’est lui et non le malade qui absorbe les « médicaments » – substances, dont l’effet est souvent violent, puisqu’il s’agit d’hallucinogènes ou de psychostimulants.
Tobie Nathan
Ethnopsychiatrie et psychiatrie transculturelle
Georges Devereux (9) a toujours affirmé que ce n’était pas lui, mais Louis Mars, l’un des premiers psychiatres haïtiens, qui fut à l’origine du mot « ethnopsychiatrie ». Il faut se souvenir qu’après la Seconde Guerre mondiale, l’ethnopsychiatrie faisait partie d’une longue série de disciplines comme l’ethnobotanique, l’ethnopharmacologie ou même l’ethnomathématique… Elles étaient basées sur l’idée que les peuples sans tradition académique avaient tout de même développé des pensées savantes, des techniques d’investigation ou des modalités d’action sur le monde, susceptibles d’être enseignées et constituant une part du patrimoine commun de l’humanité. G. Devereux affirmait qu’il n’était pas de peuple sans « ethnopsychiatrie », c’est-à-dire sans dispositifs complexes (et en général efficaces), de prise en charge des désordres psychiques. Son étude magistrale réalisée chez les Indiens Mohave (d’Arizona et du Colorado) (10) a montré qu’une petite population, de quelques milliers de personnes, avait « inventé » une nosographie d’une finesse exceptionnelle, des techniques thérapeutiques sophistiquées mises en œuvre par des thérapeutes spécifiques, des chamanes.
« Ethnopsychiatrie » se décline donc au pluriel. On parlera d’une ethnopsychiatrie mohave, comme d’une ethnopsychiatrie inuit (Sibérie) ou baga (Ouganda). On comprend aussi qu’il ne peut s’agir d’une « spécialité médicale » ; autrement dit, il n’est pas d’ethnopsychiatres, rien que des chercheurs venus d’horizons divers (y compris de la psychiatrie), qui ont décidé de prendre au sérieux cette catégorie particulière « d’ethnoscience » que l’on nomme ethnopsychiatrie.
Cette méthodologie, dont les contours ont été dessinés par G. Devereux, se situe aux antipodes de ce que l’on a pris l’habitude d’appeler « psychiatrie transculturelle ». Elle va contre le sens commun qui voudrait qu’un clinicien s’appuyant sur les travaux d’anthropologues, s’étant généralement rendus sur le terrain, entreprendrait avec ses patients des consultations – voire des cures – « adaptées », sachant tenir compte du contexte culturel. Non ! L’ethnopsychiatrie est une discipline critique et non pas une façon de sauver coûte que coûte les concepts de la psychiatrie ! Saisissant à bras-le-corps les pensées et les techniques des mondes éloignés, elle revient ensuite définir les pratiques des modernes. L’ethnopsychiatrie ne peut être qu’un outil de déconstruction des certitudes.
Tobie Nathan
|
|
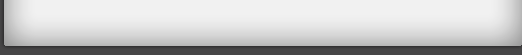 |
|
|
|
|